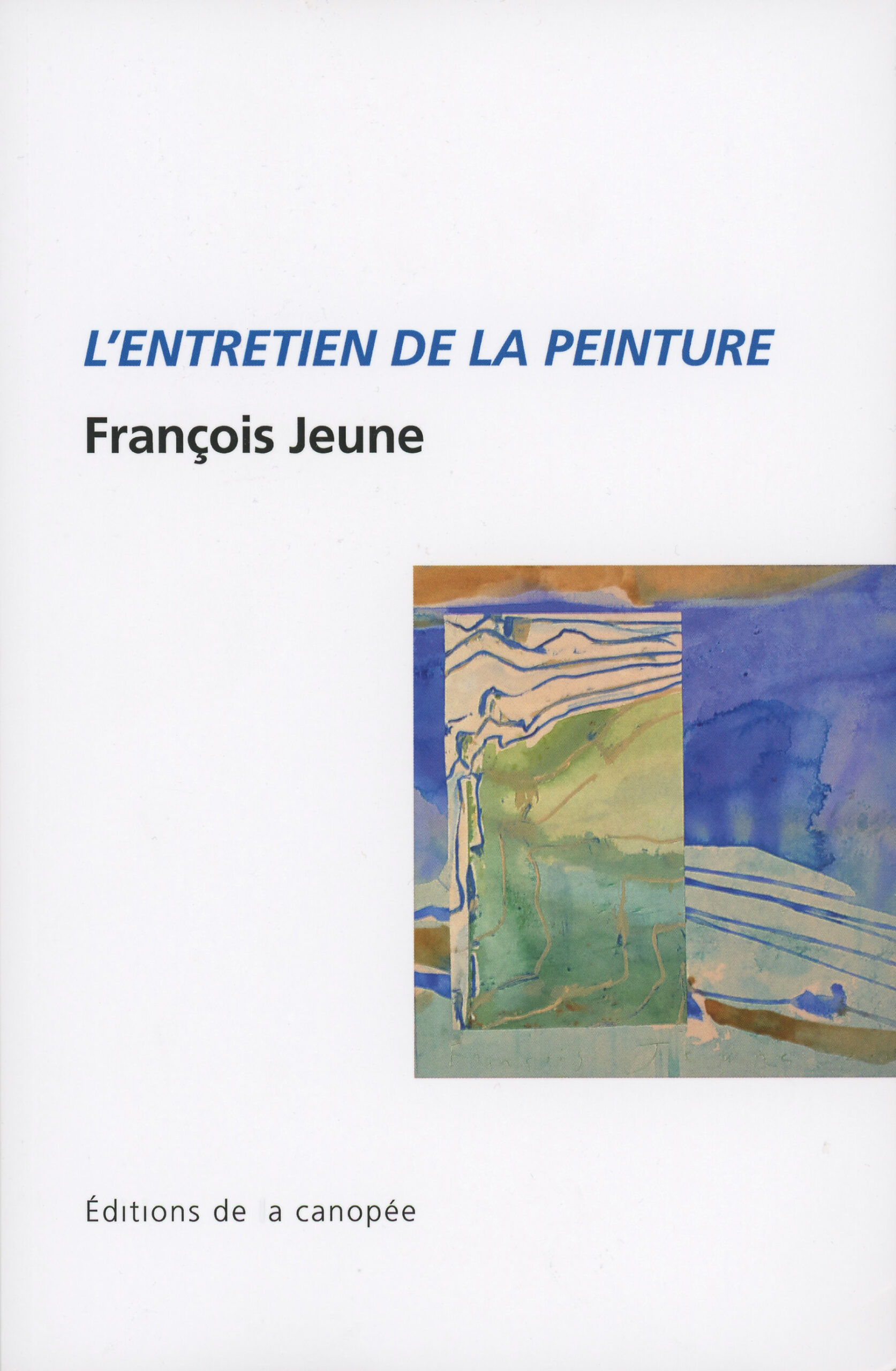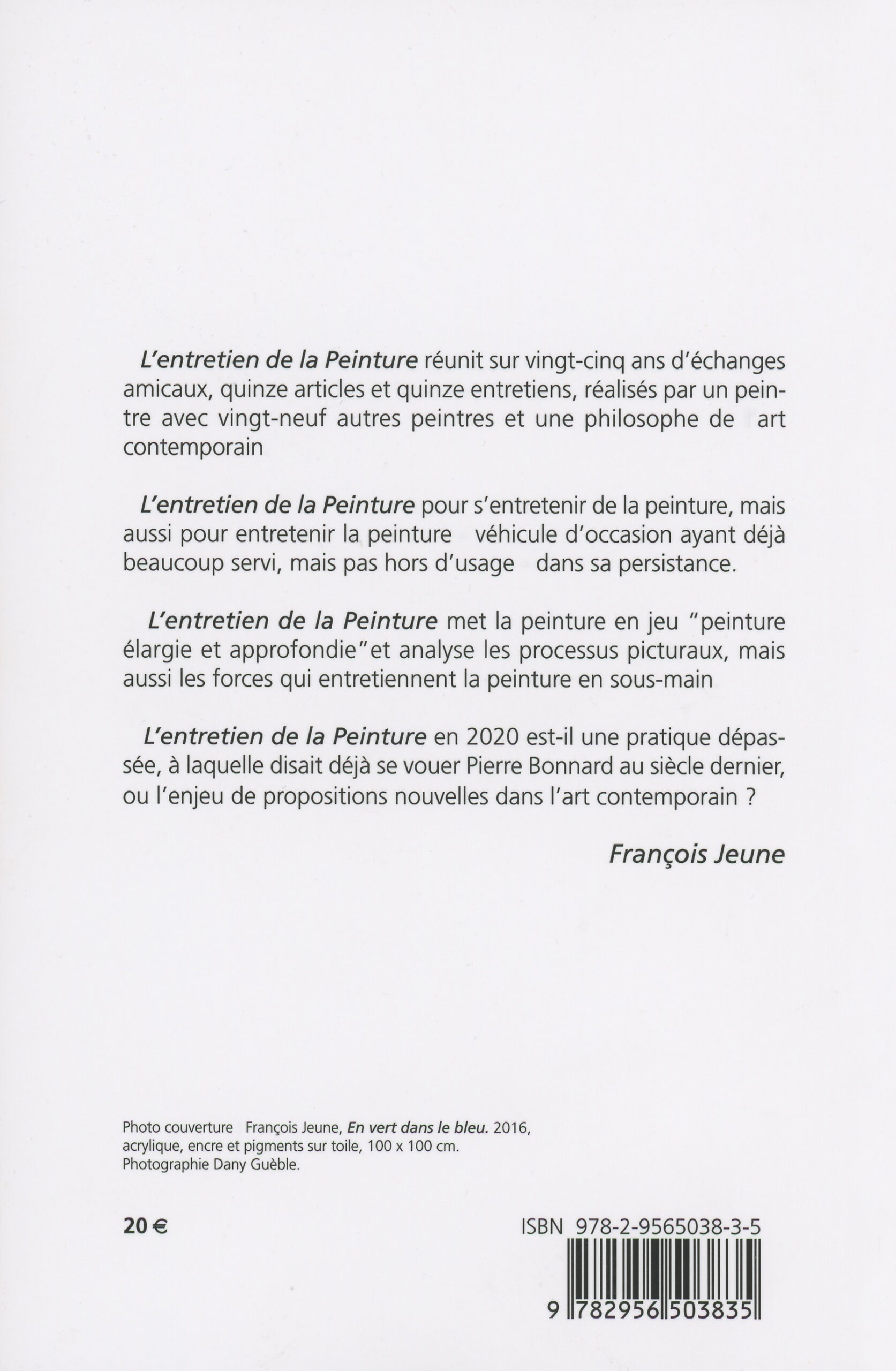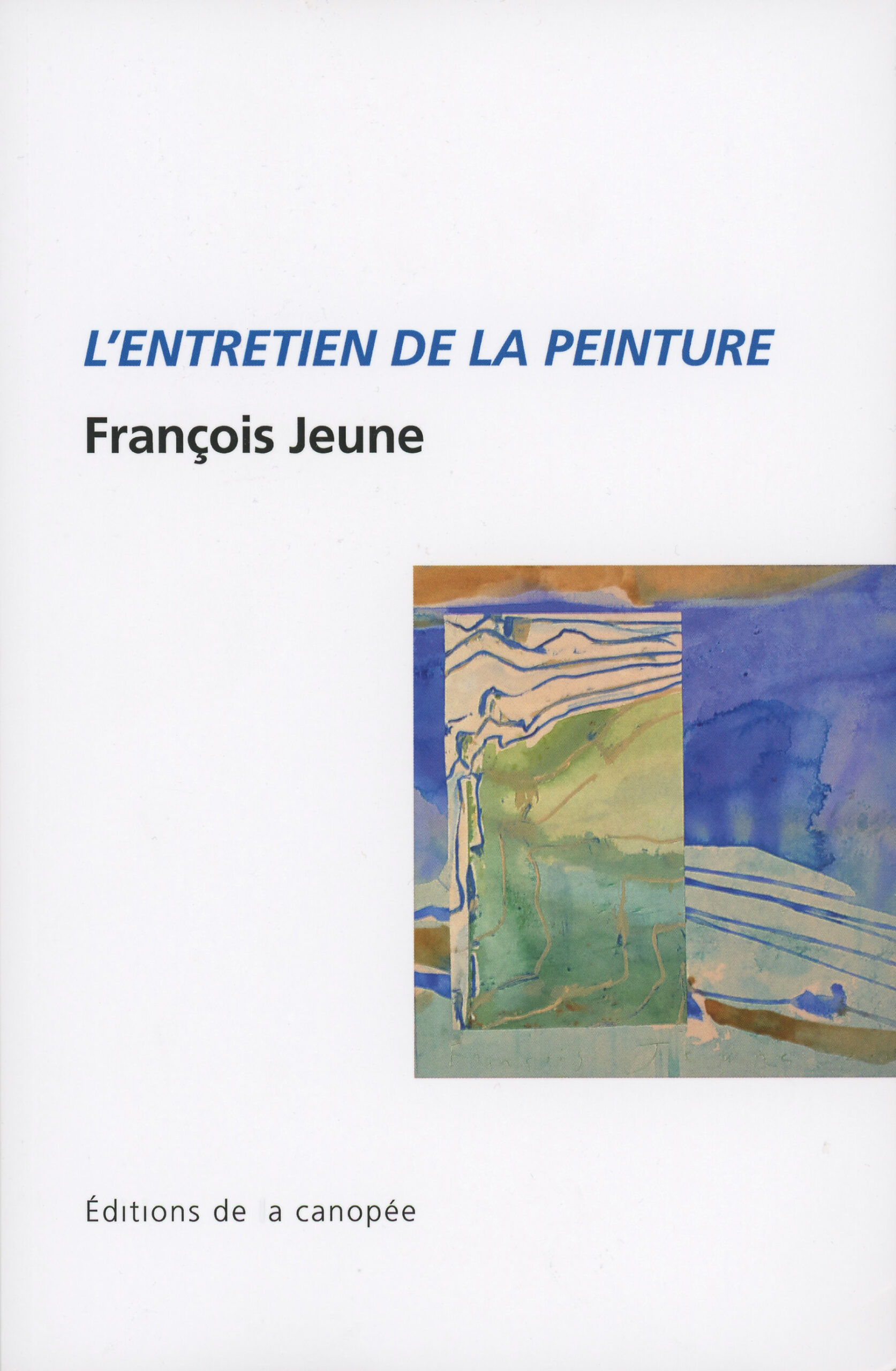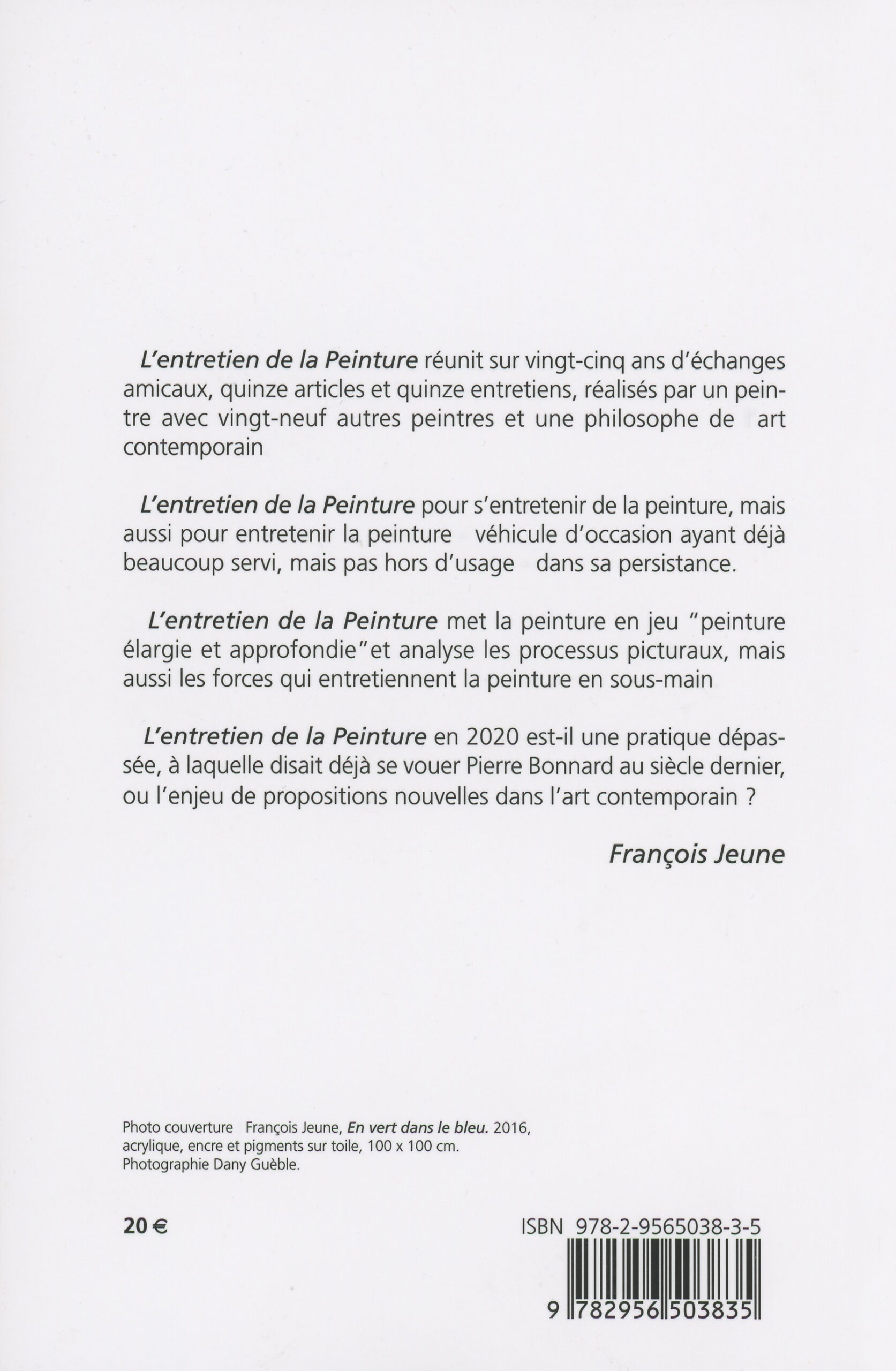Bernard Cousinier produit dans sa pratique picturale une réflexion constante sur le tableau, sous forme de plans colorés articulés, comme si des peintures différentes dialoguaient entre elles. Après La peinture dans tous ses états au domaine de Kerguéhennec, l’H du siège à Valenciennes, l’immeuble Suez à la Défense et sa transformation des angles de la galerie Pixi en 2006 en pans coupés colorés, il transforme à chaque fois, à la suite d’El Lissitztky et de sa série Proun, le lieu d’exposition en laboratoire d’une peinture spatiale, une sortie de la peinture dans l’espace.
Constructiviste ou (dé)constructiviste Bernard Cousinier ? Plutôt dans la remise en cause du plan rectangle du tableau traditionnel. Son passeplan paysage de 2015 qu’il expose chez Marie-Victoire Poliakoff comme théorème pictural, présente cinq plans colorés, trois frontaux et deux latéraux…cinq dimensions réunies et non plus deux dimensions et demi, comme disait Frank Stella de sa peinture sculpturale. Le canton, qui s’évade dans l’espace à droite, sur lequel se posent trois coups de brosse, vert, gris et rose horizontalement, était originellement le support de tests picturaux d’atelier datant de plusieurs années pour des réalisations murales. Cousinier intègre dans le processus actif de sa peinture ce qui n’était qu’essai. Au centre un rectangle blanc monochrome souligne par son seul exhaussement sa fonction-tableau comme élément mobilier détaché. Alors que l’élément aux bandes colorées horizontales est dans le même plan que ce monochrome blanc, à gauche est mis en avant dans un troisième rectangle vertical la couleur industrielle d’une plaque d’acier chromé, présence du matériau brut. La tranche à gauche est dans un vert cru et franc et à droite dans un rose vif qui rappelle sa peinture à la chaux aérienne, sept ans au mur de l’art dans les Chapelles.
Formalisme ? Non pas car chez Cousinier la nécessité de la peinture de s’échapper du rectangle du tableau, émerge de la mise à l’épreuve des plans colorés par construction et instinct, mettant chaque pièce en vibration -comme ici entre le rose et le vert, la chaux et l’acier- sur le fil du rasoir. Ce décrochement, ce déhanchement du plan latéralement et en profondeur, ce passeplan fait que le rectangle du tableau n’est plus chez Cousinier un tout fermé dans une unité fictive de convention, mais un montage ouvert. Le relief se décroche comme une main tendue dans l’espace du spectateur. Dans une séquence des Marx brother’s, comique mais aussi caustique, Harpo répond à celui qui lui tend la main, en posant sa jambe sur le bras de son interlocuteur interloqué ! Pour moi les arrangements spatiaux de Cousinier viennent vers le spectateur un peu de la même manière, par un questionnement muet. Chez Cousinier comme le dit Gérard Durozoi : «exposées ses surfaces irrégulières imposent aisément non seulement leur présence, mais surtout leur rythme et aussi les échos qui peuvent les unir». Par le dépli du mur Bernard Cousinier ouvre un espace vivant de plans colorés.
François Jeune : Comment es-tu passé de ces tableaux passe-plan qui restent encore transportables à des installations fixes dans l’espace ? Et que recherches-tu dans ces installations qui ne sont ni tableaux ni sculptures ni même installations…une catégorie à inventer de peinture dans l’espace ?
Bernard Cousinier : Toutes ces pièces sont issues du tableau. Le passeplan est une réflexion de peintre non de sculpteur. Je considère mes pièces en trois dimensions comme des «structures». Elles découlent du plan en prenant de l’épaisseur vers l’avant, en se détachant du mur, en se déployant dans le lieu et avec lui. La peinture glisse du plan vers les côtés, puis saute dans l’espace. De la même manière le plan se fait nomade de lui-même, en se structurant ailleurs loin du mur mais y reste lié par la similitude des formes que la couleur orchestre. C’est ce lien entre les différentes pièces que le spectateur recrée dans ses propres cadrages visuels.
F J : Parti d’une peinture informelle dans les années 80 tu poursuis une aventure picturale plutôt du côté de la géométrie sans être non plus un héritier de l’art construit. Une géométrie gauche ? Une géométrie souple ? Une géométrie en crise ?
B C : Avant ces années 80, j’avais déjà recours à des compositions marquées par l’accentuation du rectangle et la prédominance de la verticalité. Cette période de peinture informelle n’a été pour moi qu’un nécessaire passage. Je suis revenu à des compositions géométriques non par goût particulier pour la géométrie mais parce qu’avec ses capacités elle pouvait me permettre de manière claire et efficace, d’asseoir le «principe de verticalité» et «le mouvement latéral» du plan. Cependant je gardais avec la géométrie la même relation sensuelle que j’ai toujours entretenue avec la peinture. Alors des trois termes que tu proposes c’est plutôt celui d’une « géométrie souple » qui conviendrait.
F J : Pourquoi emploies tu souvent des couleurs à la chaux ? Tu alternes entre couleurs adoucies -roses beiges brun gris bleutés- et couleurs plus vives. En dehors de ces couleurs primaires ou éteintes, vois tu une troisième voie pour la couleur ?
BC : Je me questionne avant tout sur des problèmes de formes et de mouvement. La couleur vient en fonction de leur contexte. La couleur sourde de latex/caoutchouc, le rose/rouge, les couleurs saturées etc. sont des couleurs qui sont induites par la géométrie pour arrondir ses angles, lui donner de la sensualité ou faire rouler la couleur. Ainsi dans l’oeuvre de l’Art dans les Chapelles le rose/ rouge était amené par contraste au bleu de la voûte. A propos des cuves peintes des Tanneries d’Amilly, cuves où l’on traitait les peaux non les teintait, je voulais créer un bain de couleurs au pied des très grandes formes monochromes noires que j’avais déployées sur le mur, étaler un tapis de couleurs chaudes, issu du sol et qui aspirait le regard vers le fond. La mise en place couleur s’est faite comme toujours, d’abord de manière intuitive puis réfléchie afin de régler leur intensité et leur renvoi des unes aux autres. J’avais utilisé des pigments mélangés à de la chaux (chaux aérienne) pour ne pas réaliser juste un «recouvrement de peinture». Par ses propriétés, je pouvais «imprégner » la couleur en dedans, comme pour s’approprier un peu de l’histoire du lieu. Deux noirs différents intervenaient dans cette polychromie. Les bondes passant de cuve en cuve permettaient de jeter un oeil malicieux d’une couleur dans une autre.
F J : Quels sont les artistes et les œuvres qui te paraissent significatifs historiquement et aujourd’hui pour cette sortie de la peinture dans l’espace ?
B C : En 1990, Mas o Menos de Frank Stella m’apparaissait en lien avec ce que j’étais en train de réaliser en construisant mon passeplan : un principe basique d’une composition qui devient structure alors que la structure est elle-même composition. Le monochrome a fait basculer le regard. Alors que le tableau entretenait les formes en son sein voilà que, soudain unifié en une seule et même couleur, il se fait à son tour forme dans le mur, y choisit sa place et …peut étroitement être lié aux dimensions et couleur de ce fond qui l’entoure. La liste est longue des peintres qui ont emmené un questionnement sur le statut et les limites du tableau…Je ne manque pas l’occasion de voir des installations de Sol Le Witt, Richard Long, Daniel Buren ou James Turrell, comme de tous ceux qui s’imprègnent des lieux en les investissant. La matière du temps de Richard Serra au Musée Guggenheim de Bilbao, ou Promenade à la Monumenta 2008 du Grand Palais ou Clara-Clara si manquante à l’entrée des Tuileries, me paraissent des oeuvres majeures faisant de la forme un espace, du matériau et de la gravité presque une couleur.